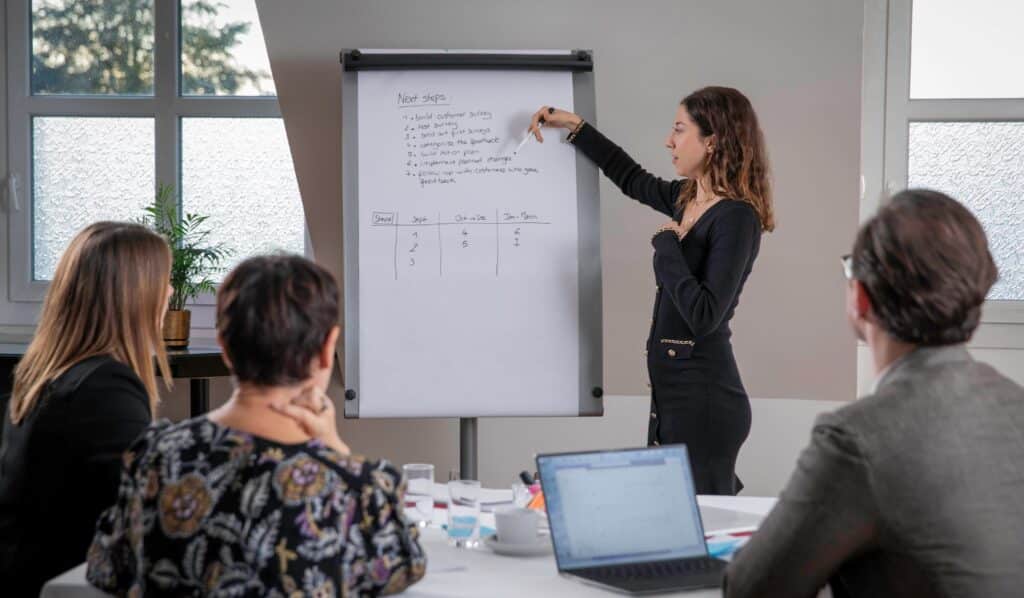La gouvernance d’entreprise en Europe s’apprête à connaître une transformation majeure. La directive sur le devoir de vigilance (Directive 2024/1760), adoptée à une large majorité au Parlement européen (374 voix pour), va redéfinir les obligations des grands groupes qui opèrent sur le marché unique européen. Prévue à partir de 2027, cette transformation réglementaire est désormais incertaine, plusieurs États membres, dont la France et l’Allemagne, ayant exprimé des préoccupations et demandé un report.
L’innovation majeure ? Une portée extraterritoriale sans précédent. Le législateur européen étend son emprise au-delà des frontières de l’UE, en incluant dans son périmètre les groupes étrangers actifs sur le marché communautaire.
Un arsenal réglementaire renforcé
L’Union européenne a renforcé son dispositif de régulation avec l’adoption de la directive CS3D, mais son application reste incertaine. Certains États membres, dont la France, plaident désormais pour un report ou un allègement des obligations afin de réduire la pression sur les entreprises.
Si la nouvelle directive sur le devoir de vigilance (Corporate Sustainability Due Diligence) devait franchir un cap supplémentaire en exigeant des actions concrètes, la demande de report sine die formulée par la France remet en question son calendrier d’application. D’autres États, comme l’Allemagne, plaident pour des ajustements afin d’atténuer l’impact des nouvelles obligations sur les entreprises.
Cette évolution témoigne du rôle central que l’UE entend jouer dans la transition écologique, en contraignant les entreprises à aligner leurs activités sur les objectifs de l’Accord de Paris. Une approche qui lie désormais explicitement performance économique et responsabilité sociétale.
Des obligations qui redessinent les pratiques d’entreprise
La mise en conformité s’annonçait comme un défi majeur pour les directions générales et juridiques, mais l’avenir de la directive reste incertain. Alors que la CS3D devait imposer la mise en place d’un système complet d’identification et de gestion des risques, la position de la France, qui demande un report sine die, pourrait ralentir, voire bloquer son application à l’échelle européenne.
L’élaboration d’un plan de transition climatique aligné sur l’objectif de limitation du réchauffement à 1,5°C constituait une autre obligation phare, plaçant la lutte contre le changement climatique au cœur des stratégies d’entreprise. Toutefois, avec les discussions en cours sur un éventuel allègement des obligations pour les entreprises, notamment en Allemagne, la portée exacte de ces mesures reste à préciser.
Les PME, bien que non directement concernées par la directive, devaient bénéficier d’un accompagnement spécifique pour faire face aux nouvelles exigences transmises par leurs partenaires commerciaux. Si ce volet demeure pertinent, son déploiement pourrait être retardé si la directive venait à être remaniée sous la pression de certains États membres.
Un déploiement stratifié et progressif
La directive sur le devoir de vigilance des entreprises cible 11900 entreprises européennes, dont 1582 françaises, ainsi que 6000 sociétés non européennes actives dans l’Union européenne. Pour ces derniers, ceux qui réalisent plus de 450 millions d’euros de chiffre d’affaires dans l’UE, le défi est de taille : ils devront adapter leurs pratiques aux spécificités du marché européen et développer une expertise locale pour répondre aux exigences légales dans chaque État membre. Dans de nombreux cas, cette adaptation passera par une collaboration avec des experts juridiques et des consultants spécialisés dans les pays européens concernés.
Le calendrier de déploiement, initialement prévu entre 2027 et 2029, est désormais incertain. La demande de report sine die formulée par la France remet en cause l’échéance de mise en œuvre, et d’autres États membres, comme l’Allemagne, expriment des réserves quant à certaines obligations.
De même, le délai fixé aux États membres pour transposer la directive dans leur législation nationale d’ici mi-2026 pourrait être repoussé, en fonction des discussions en cours au sein de l’Union européenne. Une décision sur le maintien ou l’ajustement de ce calendrier pourrait être prise lors des prochaines réunions de la Commission européenne.
Un contrôle renforcé aux sanctions dissuasives
Le dispositif de contrôle initialement conçu comme rigoureux,pourrait être remis en question en fonction des ajustements décidés par les États membres. Chaque État membre désignera une autorité nationale de surveillance, coordonnée au niveau européen par un réseau dédié. Ce système garantira une application harmonisée des nouvelles règles à l’échelle du marché unique.
Les sanctions prévues initialement sont particulièrement dissuasives, avec des amendes pouvant atteindre 5% du chiffre d’affaires mondial. Pour un groupe réalisant 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, par exemple, cela représenterait une amende potentielle de 500 millions d’euros. Ces montants s’alignent sur d’autres réglementations européennes majeures, comme le RGPD (4%) ou les règles de concurrence (10%). Au-delà des sanctions financières, la responsabilité civile pourra être engagée, imposant une indemnisation complète des préjudices causés.
Une opportunité stratégique à saisir
Même si son application reste incertaine en raison des demandes de report et d’ajustements, cette refonte du cadre réglementaire pourrait marquer un tournant vers une économie plus responsable.
L’harmonisation juridique européenne, au-delà des contraintes qu’elle impose, ouvre des perspectives stratégiques pour les entreprises proactives. En anticipant ces nouvelles exigences, ces dernières peuvent non seulement se conformer à la loi, mais aussi renforcer leur résilience, attirer les investisseurs ESG et gagner en compétitivité sur le marché mondial. Le succès de cette transformation reposera sur l’engagement des États membres et sur la capacité des entreprises à en faire un levier d’innovation.
Sources :
- Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité : le Conseil donne son approbation définitive – 24 mai 2024 – Conseil européen ; Conseil de l’Union européenne
- Devoir de vigilance des entreprises : les députés adoptent des règles en matière de droits humains et d’environnement – 24 avril 2024 – Parlement européen
- Corporate sustainability due diligence – Commission européenne
- Lettre de la DAJ – Le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité – Rapport de l’Assemblée nationale; 20/07/2023